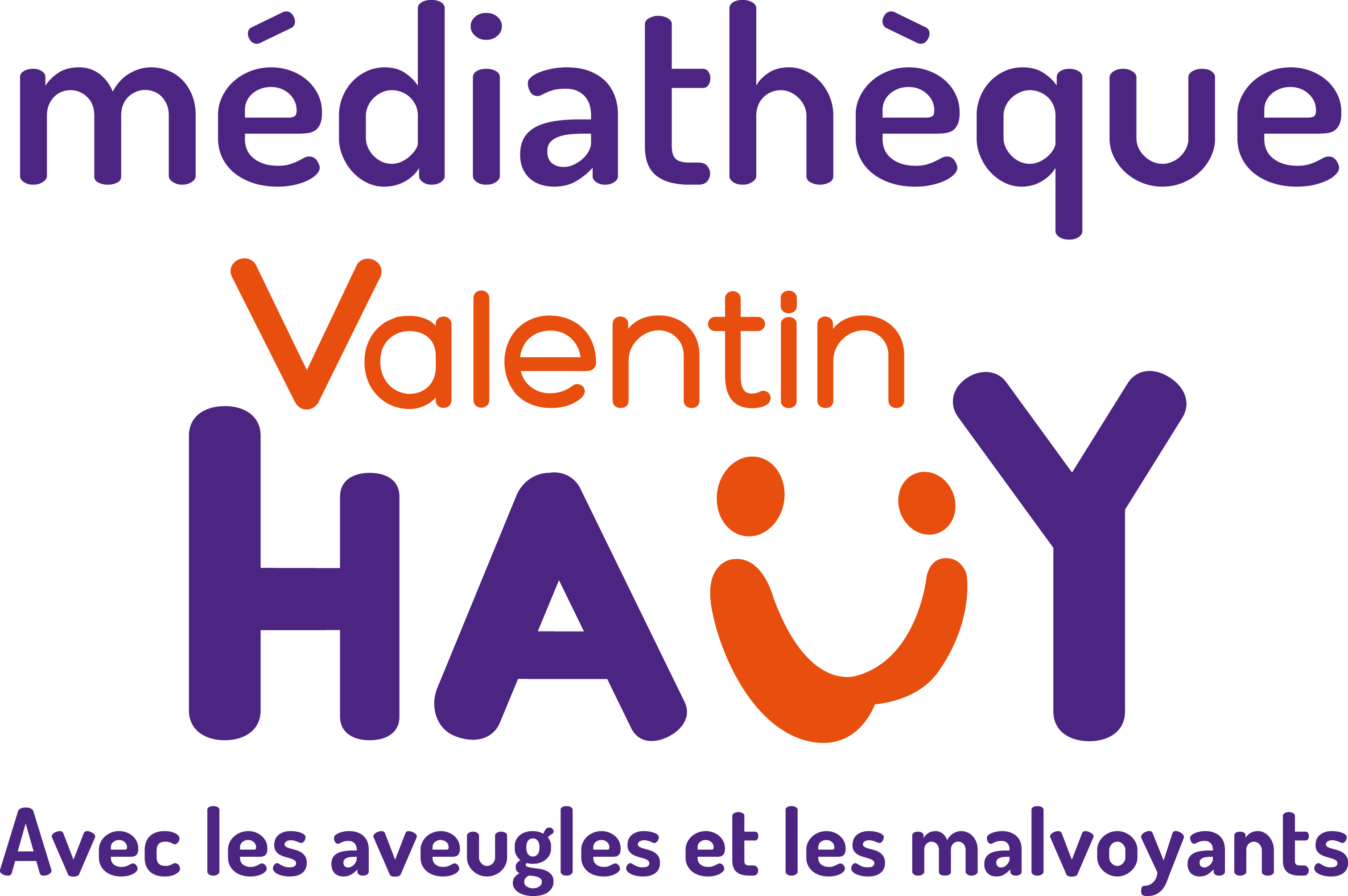Canada

Le curé Labelle fut, au XIX siècle, l'un des grands architectes du Canada français.

Une analyse critique sur le pouvoir et son usage tel que pratiqué au Québec durant l'ère de Robert Bourassa. L'ouvrage est basé sur quelque deux cents heures d'entrevues et plusieurs centaines de documents confidentiels. Suivi par "Le naufrageur: Robert Bourassa et les Québécois, 1991-1992"

À partir d'un nombre impressionnant d'entrevues qu'il a réalisées, l'auteur, un journaliste, a produit cet imposant ouvrage sur le pouvoir et son usage. Un pouvoir tel que pratiqué au Québec durant cette période où, affirme-t-il, la duperie et le double langage y ont pris presque toute la place. Suite de "Le tricheur: Robert Bourassa et les Québécois, 1990-1991"

Les combats perdus, les « prochaines fois » réitérées sans relâche, les projets inachevés encombrent le pas de notre destin. Rien n’est jamais tout à fait fini au Québec. Le passé se prolonge donc dans le présent de manière confuse, malgré la soi-disant coupure de la Révolution tranquille. Parce que, peu importe ce qu’on en dit, peu importe ce qu’on en pense, le passé finit toujours par percer, comme la pyrite dans un sous-sol de bungalow. Le problème, ce n’est pas nécessairement que le présent soit coupé de ses racines, comme plusieurs penseurs contemporains le dénoncent, mais bien que celles-ci aient mal poussé et aient fini par tout étouffer. Ce qui nous amène à cette question, déterminante : pourquoi plusieurs pans de notre passé et la mémoire que nous en gardons ressemblent à des chantiers inachevés dont on a perdu le sens ? Pourquoi ce passé a-t-il proliféré ainsi, presque à l’insu des Québécois ? Que signifient les problèmes d’embrayage temporel au Québec ? Quelles en sont les conséquences sur notre présent ?

Jamais un Premier Ministre québécois n’a suscité autant d’intérêt que Maurice Duplessis. Son règne a été étudié, analysé, raconté de long en large, immortalisé dans des publications écrites par des historiens, des journalistes, des collaborateurs, des opposants, des amis, des ennemis. Mais jusqu’à maintenant, personne ne s’était penché sur son rôle dans l’industrie du sucre au Québec, ni sur la manière dont il a délibérément réussi à la saboter. Alors que l’inflation fait un bond de 60% entre 1946 et 1962, cette industrie aurait pu à elle-seule assurer la prospérité de la province dans cette période où elle en avait tant besoin. Du moins, en théorie. Mais à cause de manigances et politicailleries de l’Union Nationale, nous ne le saurons jamais. Rencontrez Louis Pasquier. Ingénieur agronome français que l’on fait venir au Québec dans le but de sauver l’industrie du sucre de betteraves. Et que l’on détruisit ensuite pour avoir commis le crime d’y être parvenu.

Après 60 ans de mariage, l'auteur s'est retrouvée seule avec ses souvenirs. Elle revit pour nous son enfance, sa vie de jeune fille, son mariage. Elle nous livre son album de famille, celui d'une famille québécoise du début du siècle.

Une fenêtre ouverte sur les communautés innues : leur langue, leur légende, leur culture. José Mailhot, traductrice d’An Antane Kapesh, témoigne. Son récit passe du quotidien des Innus à leur vision de la vie. Témoin capital, José Mailhot, une Blanche chez les Innus, parle leur langue et épouse leurs coutumes. Un incontournable pour comprendre les relations entre les Québécois et les Premières Nations.

Voici qu’après trois ou quatre générations passées dans la clandestinité des bois, dans ces forêts du Nouveau Monde, aussi impénétrables que des oubliettes, une poignée de familles acadiennes s’est refait le goût du ciel et de l’eau, a repris contact avec le sable et le sel des rivages. Nous sommes en 1880... Et les gens du Fond-de-la-Baie de Memramcook, du Barachois et autres lieux, devenus gens des côtes, brisent le mur du silence et nous disent, en paroles antiques et sonores, leur vie, leurs peines et leurs amours incessées depuis ce lointain, cet opiniâtre cheminement des charrettes de Pélagie revenues du sud...

Lecture essentielle pour tout comprendre sur la question autochtone, cet ouvrage bien vulgarisé, qui vise le grand public, décortique clairement les grands enjeux d'aujourd'hui. André Maltais livre ici le fond de sa pensée sur le problème autochtone qui hante ce pays depuis sa fondation. Tout en donnant une évaluation critique, non-partisane et sans complaisance de limpasse actuelle, Le réveil de laigle est avant tout un vibrant plaidoyer pour le changement, offrant une vision novatrice et réaliste, assortie de solutions concrètes, où se dessine un avenir possible basé sur la réconciliation, le respect mutuel, la responsabilisation et le partage équitable de la richesse.

Première partie de la vie de Claire Martin, dans laquelle l'auteure nous fait part de son témoignage d'enfant battue par son père. 1981.