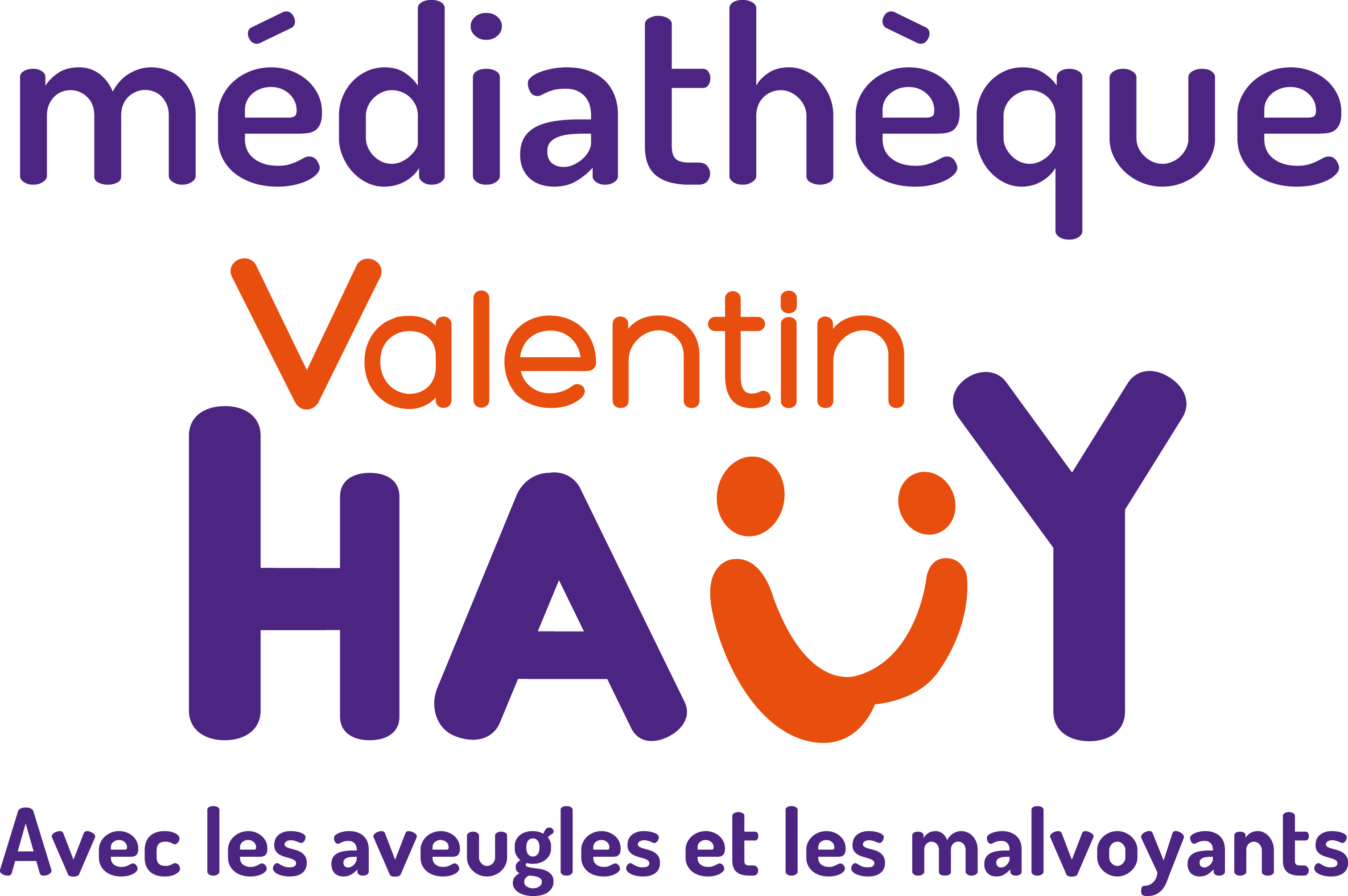Philosophie

L'ouvrage majeur d'Étienne Bonnot de Condillac est le "Traité des sensations", dans lequel il s’émancipe du patronage de Locke et aborde la psychologie de sa propre manière, formulant sa doctrine du sensualisme.

Le Traité des animaux (1755) est une critique de l’"Histoire naturelle" de Buffon de 1749.

Dans la philosophie chinoise, la Grande Étude se compose d’un canon, attribué à Confucius, et d’un commentaire en dix chapitres attribué à Zengzi, un de ses principaux disciples.

Par ces courts morceaux, remarquables par leur perfection formelle et la densité de leur contenu, l'auteur se rattache à la grande tradition des moralistes français

Il s'est passé quelque chose avec notre corps dont nous n'avons pas encore pris toute la mesure. Il était le "tombeau de l'âme" pour Socrate, la source du péché pour les chrétiens, ce dont il fallait apprendre à se détacher parce qu'il nous voue à la souffrance, à la maladie et à la mort. Ayant gagné quarante ans d'espérance de vie en un siècle, nous voyons au contraire dans le corps le lieu de notre salut. Il n'est plus notre ennemi, mais notre double : nous l'écoutons, nous le consultons, nous demandons à la science et aux technologies, mais aussi au droit et à la politique, de l'entretenir et de le protéger, au sport d'augmenter sa puissance, à la mode de l'embellir, au cinéma de le glorifier... Notre époque aurait-elle accompli la "divinisation du corps" que Nietzsche appelait de ses voeux ? Cet essai intempestif, nourri d'une très intime fréquentation de l'oeuvre nietzschéenne et portant un regard aiguisé sur les transformations de notre sensibilité, soutient que le corps est bien plutôt devenu une nouvelle idole, un fétiche idéalisé en regard duquel notre corps réel, fini, souffrant, multiple et obscur, se sent toujours en défaut, inaccompli, coupable même. Reste alors à imaginer, au-delà de tout moralisme, ce que serait l'existence d'un individu qui se conformerait vraiment à la formule de Zarathoustra: "Je suis corps tout entier et rien d'autre."

L'historien revient sur la place accordée au silence dans la vie des hommes depuis la Renaissance, montre le lien unissant l'invention de l'individu et la construction d'un retour sur soi. L'analyse s'appuie largement sur les textes littéraires, de Castiglione et Loyola à Gracq et Jaccottet, en passant par Proust et Huysmans, ainsi qu'à des oeuvres d'art (Redon, Magritte, Hopper...).

Comment les liens et les blessures qui nous ont marqués dès l'enfance structurent-ils les relations affectives entre hommes et femmes. A travers des études de cas, une analyse des rapports entre hommes et femmes, mères et fils, pères et filles.
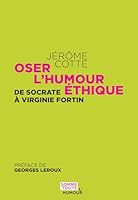
Jérôme Cotte s'intéresse à ce que les grands philosophes de toutes les époques ont dit ou écrit sur l'humour. Il s'inspire autant de la rouerie d'Aristote, qui annonce un traité sur l'humour sans jamais l'écrire, que des câlins gratuits d'Anarchopanda au printemps 2012 et de la vision du Cosmos de Virginie Fortin. Au fil de cet essai, l'auteur trace les contours de ce que pourrait être un humour responsable tout en restant conscient de la difficulté, voire de l'utopie, de l'entreprise : il faut à la fois de l'humilité et de l'audace, constate-t-il, pour tourner en dérision les pouvoirs en place, changer réellement le monde par l'humour et en faire, enfin, un milieu égalitaire et inclusif

En explorant avec minutie l'édifice central de la philosophie cartésienne, l'auteur en montre aussi certains aspects peu connus qui peuvent aider notre époque dans la tâche philosophique qui lui revient.

En explorant la vie et l'oeuvre de Rousseau, c'est-à-dire en allant du privé au public, de l'indicible à l'exprimé et du sublime au honteux, cette biographie s'attache à montrer la singularité de celui qui exprima l'universalité de la condition humaine