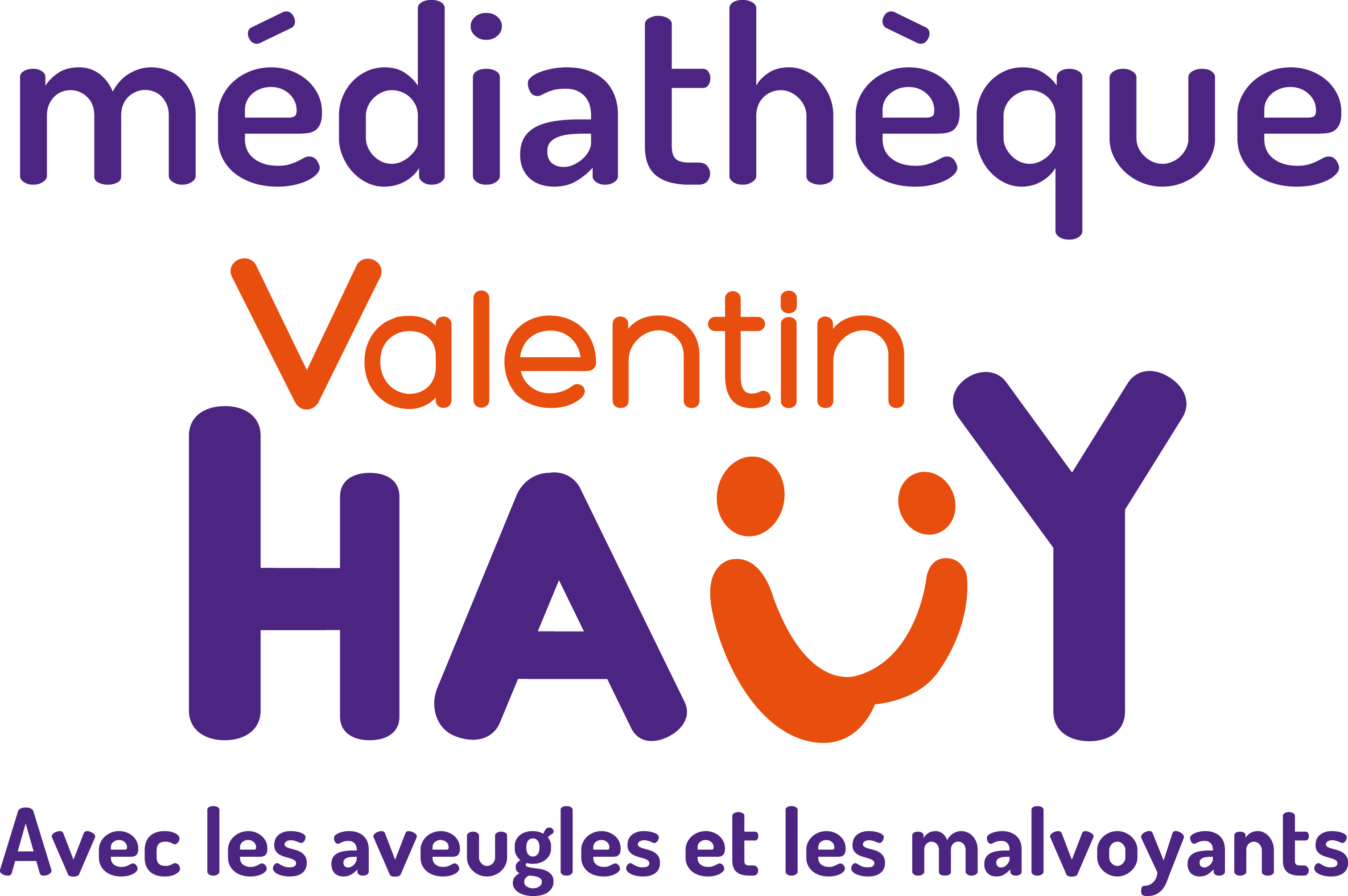Philosophie

Dans ce livre à la fois érudit et polémique, l'auteure interroge les personnalités de Socrate et de Jésus par le biais de l'histoire, des textes fondateurs, des mythes, de l'approche religieuse et philosophique. Elle montre qu'en dépit de leurs postures divergentes, les deux personnages partagent une sagesse commune. ©Electre 2019

Destinee a un large public, voici l'histoire de la philosophie qui se concentre sur l'essentiel et qui fournit le recit passionnant des progres de l'esprit humain.

Ecrit dans le vent: ce titre dit à la fois la légèreté et la fugacité. Légèreté que cette sorte de nonchalance avec laquelle l'auteur flâne pour ainsi dire dans sa vie; s'arrête, pensif, près d'un chat; jette un regard doucement mélancolique sur le temps qui est déjà passé; s'émerveille de la présence d'un arbre dans le coin du paysage; se confie à l'instant présent, s'abandonne doucement à ses sortilèges. Ce qui n'exclut pas, çà et là, une bouffée de nostalgie, l'ombre portée d'un désespoir qu'on veut tenir à distance. Mais la tonalité dominante de ce livre, ce qui lui donne ce charme qui ne désarme pas et qui est sa vérité la plus grave, c'est ce sentiment permanent des choses qui passent, des instants qui s'en vont irrémédiablement, des êtres qui déjà s'éloignent. Le beau projet de vouloir retenir un peu la vie était en fin de compte possible, à condition que le livre dans lequel il se réalisait nous vienne «sans rien en lui qui pèse ou qui pose», comme en passant: qu'il soit écrit dans le vent.

Grand connaisseur de l'oeuvre et de la pensée d'A. de Tocqueville, l'auteur décrit une personnalité complexe et dévoile les doutes et les interrogations de ce combattant de la liberté. A travers une série de citations commentées, sont exposées sa conception de la démocratie et ses dérives, ses positions sur le système pénitentiaire, sur l'abolition de l'esclavage et sur la politique française. ©Electre 2020

Quand les pierres se mirent à rêver est le fruit d'une réflexion sur la solitude, non seulement vécue comme un état, mais aperçue comme un lieu. Ce lieu bien sur est intérieur à l'homme, tout entier délimité par cet objet étrange qu'est le corps, qui est son hôte. Pourtant, il est suggéré dans ces pages que quelque chose dans cette solitude relie le corps au reste du monde, et ainsi ne cesse de le convier à une forme de célébration. Il ne s'agit pas tant ici d'expliquer cela. Ou si on l'explique, ce ne sera jamais qu'au moyen d'une certaine poésie.

Réflexion sur le caractère paradoxal de la condition humaine, l'importance et parallèlement l'insignifiance de la vie humaine, l'individualité et la collectivité.

'' Les professeurs d'espérance n'ont qu'un seul argument: lorsque le danger ou la douleur atteignent un certain degré, la conscience se réveille et l'être humain s'adapte, cest-à-dire qu'il opte pour des comportements favorables à sa survie. La conscience: un guide sûr! Un argument en apparence très fragile. Il suffit habituellement d'un sourire pour qu'il s'écroule dans le scepticisme ou l'indifférence du jour. Pour avancer sur un tel chemin, il faut croire en la conscience, en la pensée et en la vie, trois formes de lumière qui ont perdu toute recevabilité dans notre monde soi-disant postmoderne. Pourtant, l'auteur soutient ici que le mouvement de la société civile en faveur de l'écologie n'est pas une mode, mais la manifestation d'une conscience en marche, elle-même constitutive de la vie. Solidement enraciné dans la physique contemporaine et l'histoire de la pensée, cet essai propose un fondement métaphysique à l'espérance, un changement de mentalité nécessaire à notre avenir, et une pratique courageuse de la participation à la vie. On trouvera ici un étonnant traité sur la conscience dans son sens le plus large et le plus engageant.

S'il y a une menace qui pèse sur l'humanité, elle ne vient en premier lieu ni du réchauffement bien réel de la planète ni de la mondialisation ; elle vient de la manière dont nous exerçons le pouvoir

Dans cet antimanuel, F. Bégaudeau pose de nombreuses questions sur la littérature, l'écrivain, la création littéraire et le lecteur, et y répond avec un humour démystificateur.

Partout où notre regard se tourne, il y a du flou, du fuyant, du non-assuré. On le sait, nos sens nous trompent, nos sentiments nous aveuglent, nos théories sont des constructions de langage dont la validité est limitée et provisoire, nos concepts morcellent la réalité sans arriver à la saisir telle qu'en elle-même. Ce que nous considérons comme des connaissances sont le plus souvent, pour chacun de nous, des croyances. Devant cet état de choses, on peut se désoler et se prendre à regretter les temps où la religion révélait le sens de la vie, qui en semble soudain privée. Nous voudrions encore des certitudes absolues, des vérités définitives. «On pense ne pas pouvoir supporter l'existence si on ne s'en fait pas une représentation dorée. On croit ne pas pouvoir supporter la vie si l'aléatoire, l'incertain, le relatif, l'approximatif en constituent les composantes.» Telle n'est pas la conclusion qu'en tire ici l'auteur. Amplement émaillée d'exemples éloquents et non dépourvus d'humour, sa réflexion sur les limites de notre savoir, de notre langage et de nos sens, montre au contraire que la lucidité sur notre condition permet d'aimer la vie pour ce qu'elle est, insaisissable, imprévisible, irréductible. «Après tout, c'est ainsi qu'elle est promesse de régénération ininterrompue.»